تراجنسی و بی قراری جنسی
| کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
|---|---|---|
| 32442 | 2007 | 3 صفحه PDF |
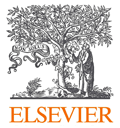
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume 165, Issue 9, November 2007, Pages 689–691
چکیده انگلیسی
The French Agency (HAS), in the Ministry of Health, provides guidelines for the treatment of gender dysphoria and transsexualism (as defined by ICD-10, WHO, and APA DSM-IV-TR). Since it is a mental disorder, psychiatric assessment and treatment are a cardinal in the standard of care, before (minimum two years) and after SRS (sex reassignment surgery).
مقدمه انگلیسی
Le transsexualisme est classé parmi les troubles mentaux dans la CIM-10 de l’OMS (1993) (F-64.0), avec pour définition : « un désir de vivre en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s’accompagne habituellement d’un sentiment de malaise ou d’inadaptation envers son propre sexe anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal, afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré. » Les critères CIM-10 exigent au moins deux ans de persistance de l’identité transsexuelle et l’absence de schizophrénie ou d’anomalie chromosomique (pas d’ambiguïté sexuelle anatomique). Ce trouble est classé dans le chapitre des « troubles de l’identité sexuelle », distinct du « transvestisme bivalent (F-64.1) : port des vêtements du sexe opposé, afin de faire l’expérience temporaire de l’appartenance au sexe opposé, sans motivation proprement sexuelle et sans désir de changer durablement de sexe ». On en distingue aussi le transvestisme fétichiste, condition requise pour une excitation sexuelle et un orgasme (F-65.1). Dans le DSM-III de l’APA (1980), le transsexualisme (302.5 X) était classé dans les « troubles psychosexuels » au chapitre gender identity disorder (identité sexuelle dans la traduction française). Les critères sont les mêmes que dans la CIM-10. Dans le DSM-III-R (1987), le transsexualisme a changé de positionnement, il passe dans le gros chapitre des « troubles apparaissant dès l’enfance et l’adolescence », toujours dans le cadre du trouble de l’identité de genre, séparé cette fois du transvestisme, restant, lui, dans le chapitre des paraphilies (perversions). Il semble que le transsexualisme ait toujours existé. On le trouve signalé dans les écrits antiques (la maladie des Scythes, par exemple et les récits ethnographiques : les berdaches, les rérés, etc.). Cependant, ce que l’on a pu décrire récemment comme une épidémie transsexuelle a correspondu aux ressources biotechnologiques apportées dans le champ de la médecine par l’endocrinologie et la chirurgie. Les médias, en particulier la télévision, ont popularisé ces situations et ces problèmes au parfum de scandale, qui ont pu susciter des vocations, certaines personnes trouvant là le secret de leur mal-être et sa solution. En outre, le relâchement des interdits juridiques a rendu licites les procédures de changement de sexe au milieu du xxe siècle. Un des pionniers [1] dans ce domaine a pu déclarer : « le transsexualisme est une pathologie iatrogène. » Une hypothèse récente plus hasardeuse suppose que la pollution écologique de l’environnement altère gravement la différenciation sexuelle et la fertilité humaine, comme pourrait en témoigner le changement de sexe de certains poissons dans les fleuves et les estuaires du monde industrialisé. Quoi qu’il en soit, la définition même implique l’absence de toute altération anatomophysiologique chez ces personnes. Cependant les ambiguïtés sexuelles (si, par définition, elles excluent le diagnostic) faciliteraient plutôt les procédures de réassignation de genre. Actuellement, le transsexualisme dit féminin (FtM) représente un quart des demandes de changements de sexe. Techniquement plus difficile que le transsexualisme masculin (MtF), il semble de meilleur pronostic psychosocial. Certains psychiatres et psychanalystes considèrent la conviction transsexuelle comme une psychose devant être traitée en tant que telle. La chirurgie est « une réponse folle à une demande folle » (Colette Chiland). Les candidats au changement de sexe se présentent de façon monotone en se déclarant victime d’une erreur de la nature, affirmant être soit « une femme dans un corps d’homme » (MtF ou H → F) soit « un homme dans un corps de femme » (FtM ou F → H). Ils veulent donc corriger cette discordance psyché–soma et cette incompatibilité. On peut donc leur proposer soit de changer leur esprit, soit de changer leur corps. La première solution est toujours récusée, bien qu’elle ait fait l’objet de quelques protocoles couronnés de succès, mais exigeant un traitement psychologique, cognitif et comportemental, quotidien et prolongé relevant beaucoup plus du domaine expérimental (AGRAS) qu’une possibilité thérapeutique généralisable, malgré les efforts de Lothstein, par exemple [2]. Il n’existe pas, à ce jour, de théorie ni d’interprétation psychosociale ou psychobiologique du phénomène transsexuel. Stoller avait proposé, il y a quarante ans, une lecture métapsychologique, en rupture avec la théorie freudienne orthodoxe, faisant du transsexualisme masculin primaire une empreinte et une identification primaire massive à la mère, dans une symbiose fusionnelle maintenue par la mère et non troublée par un tiers. Dans cette optique, tous les transsexualismes féminins (FtM) sont secondaires, ainsi que nombre des transsexualismes masculins. Stoller, bien que psychanalyste de tradition orthodoxe, estimait impossible de modifier cette identité féminine primaire du transsexuel masculin et acceptait la transformation hormonochirurgicale, qui nécessitait un accompagnement psychologique et une éradication des restes de masculinité, après changement de sexe. Depuis une quinzaine d’années, une contestation philosophique s’efforce de mettre un terme à l’opposition simpliste assignant obligatoirement chacun à l’un des deux genres homme ou femme et milite pour une totale liberté et variabilité dans le choix et l’exercice de son genre [3]. On a pu aussi accuser les transsexuels de conformisme social. Par exemple, Janice Raymond [4] affirme que les supposés transsexuels sont victimes des préjugés sociaux et n’assument pas une homosexualité ou une bisexualité sous-jacente et veulent coller, en les exagérant de façon caricaturale, aux stéréotypes anciens masculin ou féminin. Par exemple, dans un pays islamiste tel que l’Iran où l’homosexualité est passible de punitions très graves, le transsexualisme et le changement de sexe sont tout à fait admissibles en tant que pathologies. L’HAS (Haute Autorité Santé) a décidé d’encadrer les procédures de changement de sexe et de proposer des règles de conduite à tenir (guidelines). Quatre centres de référence sont actuellement reconnus : CHU de Bordeaux, Marseille, Paris et Paris-Suresnes. Le consensus s’est établi dans le cadre – initialement proposé par la HBIGDA (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association) ; il avance les règles suivantes : le changement de sexe peut être accordé à un adulte mature et autonome, ayant une bonne insertion sociale, avec de préférence un métier. Il doit faire l’objet d’une évaluation psychopathologique prolongée par des professionnels de santé mentale formés dans ce domaine. On demande généralement une période probatoire de deux années pendant laquelle la personne candidate verra régulièrement un psychiatre. L’endocrinologue pourra éventuellement commencer la prescription d’hormones pendant la deuxième année du suivi. À la fin de la deuxième année, un chirurgien pourra entreprendre les interventions transformatrices. On insiste sur ce que les Anglo-Saxons appellent le real life test, c’est-à-dire une période pendant laquelle la personne candidate vivra dans le rôle et les apparences (en particulier vestimentaires) du sexe désiré. Le psychiatre s’assurera de la non inscription de cette conviction et de ce désir dans l’évolution d’un trouble psychotique, d’une dépression sévère ou d’une manipulation psychopathique et perverse. Il existe des transsexualismes secondaires, symptomatiques, transitoires. Il existe aussi des crises transsexuelles réactionnelles et des troubles factices ou dissociatifs ou utilitaires. Le psychiatre s’assurera aussi de la parfaite compréhension de la procédure de transformation, de ses implications techniques et sociales. La stabilité de l’engagement sera testée tout au long de la période probatoire. Idéalement, le sujet s’engage à garder au long cours le contact avec l’équipe, ce qui permettra de confirmer la validité de ces procédures qui soulèvent encore beaucoup de réticences dans la communauté médicale et psychiatrique, ainsi que dans la société en général. On constate aussi une tentation communautariste avec un certain activisme de plusieurs associations de « consommateurs » qui souhaitent voir dépsychiatriser le transsexualisme. Pourtant c’est l’inscription de ce « trouble » (disorder) dans la liste de l’OMS et de l’APA qui permet légalement ces procédures et leur paiement intégral par la Sécurité sociale. Le mouvement GLBT (Gay-Lesbiens-Bisexuels-Trans) veut rassembler toutes ces « minorités sexuelles » en un seul groupe de pression et de consommateurs et lutter contre les homophobes et les transphobes… Le problème du remboursement par la Sécurité sociale dépend d’une autorisation du médecin conseil national (CNAM). Outre le suivi psychiatrique et endocrinologique et les procédures chirurgicales (avec quelques variations, selon les équipes), les transsexuels vont changer de prénom et d’état civil. Restent quelques problèmes pour le remboursement des interventions annexes, telles l’épilation au laser chez les hommes, l’ablation de la pomme d’Adam, la calvitie, la mammoplastie, la rééducation de la voix, etc.

